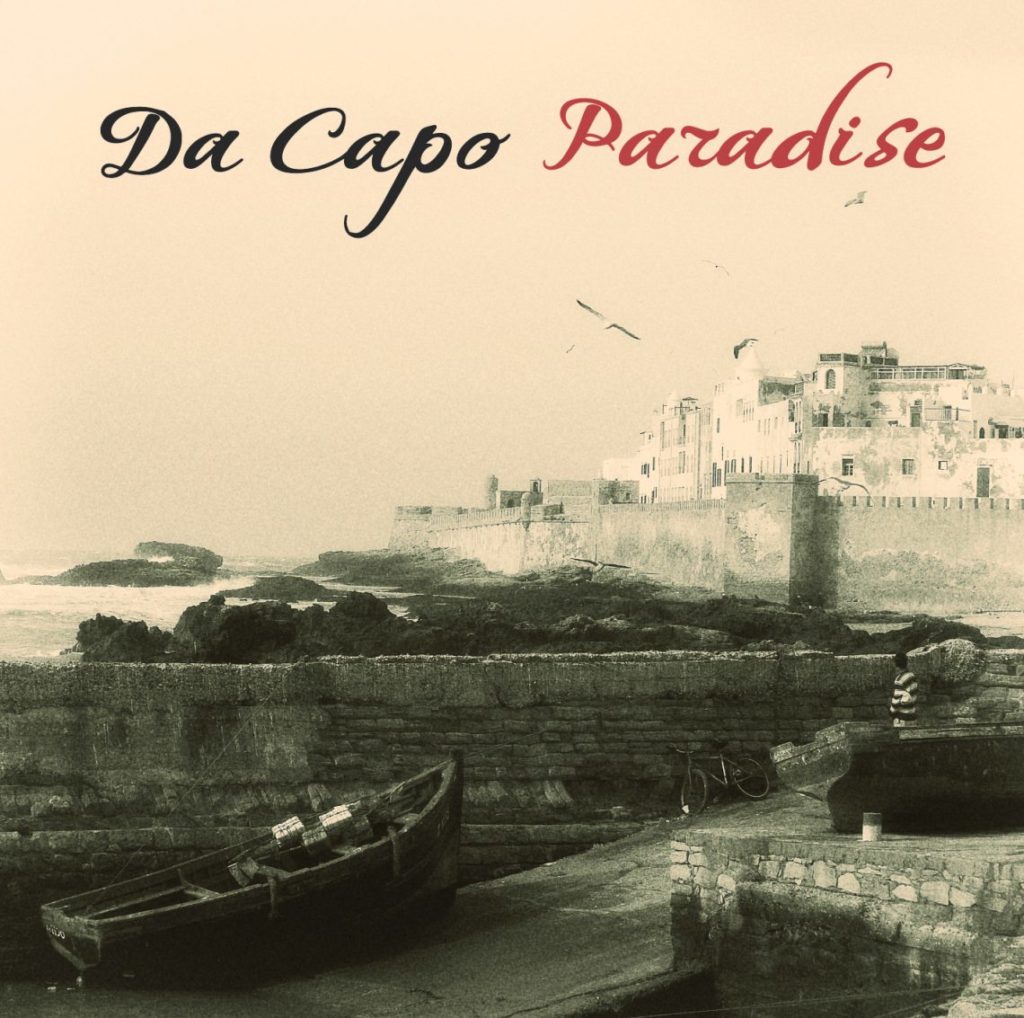Adepte d’une pop dite « inclassable » -je dirai plutôt, pour le coup, variée-, le Da Capo d’Alexandre Paugam en arrive avec Paradise à son septième album. Rodé, donc, à l’épreuve de magnifier le genre en question, il élabore là une oeuvre qui, du rageur et positivement surprenant Help me en ouverture à Horn’s lament qui clôt les débats dans un jazz feutré mais sauvage, free et grinçant autant que velouté, se pare de mille couleurs et atours. L’attrait se renouvelle sans cesse, on est à peine remis du choc -à réitérer plus souvent, quand bien même cet avis n’engage que moi- initial que Mistress, orchestral et magnifique, nous éclabousse d’élégance. On pourrait s’attendre à un essai délicat, sans relief, dédié tout entier à la douceur. Mais non: Da Capo, soucieux de « musicaliser » son disque, marie le majestueux et le plus emporté, orné classieusement. On ne se contente pas, sur ce Paradise, de faire dans la flanelle: on met du charnel qui, même mesuré, fait son effet. Too late, délicat, complète joliment un trio introductif de bon augure quant à la suite de l’opus, qui elle aussi fera bonne figure. On ne perd donc pas la face, Following you impose tout à la fois prestance vocale et flamboyance instrumentale. Trompette, violon et saxophone, sur Paradise, sont de la partie et d’un bel apport.
Les climats sont de plus divers, le tout, de façon constante, arrangé avec gout et moultes bonnes idées. Hold on, subtil mais animé, faisant dans la sobriété. Qu’on dénude ou qu’on vêtisse les morceaux, on parvient à un résultat de choix. Ses voix portent un ressenti perceptible, elles peuvent aussi se faire amples et intenses. Lonely, saccadé et plutôt déviant dans sa beauté, fait briller les cuivres et se veut alerte. Au fil de l’écoute, de multiples détails décisifs surgissent et consolident un disque dont Da Capo peut tirer une certaine fierté. Un Paradise dont les contours se refusent à n’être que Paradisiaques, ne rechignant pas à s’écarter du droit et pénible chemin qu’est celui de la pop rangée et soumise. On espère d’ores et déjà le voir, ce groupe soudé, lâcher les rênes, à l’avenir, plus souvent encore.

Le procédé est en bonne voie, on ne le contestera pas. My life trouve sa source dans une effluve jazzy enfumée, cabaresque, au chant sensible. La seconde partie du titre, ombrageuse, le magnifie. Tribalism, bien nommé, dépayse. Le pouvoir de Paradise réside là, dans son aptitude à faire voyager celui qui s’y tiendra. Il le faut, l’écoute exige l’implication car à tout moment peuvent survenir ces sons, ces passages, ces voix aussi, qui font la différence et portent l’opus plus haut qu’un autre. Can you hear me, semble demander Da Capo quand se profile la fin de ses ébats. Bien entendu, on l’entend et on le reçoit. La chanson, exempte de rythme, remplit pourtant l’espace. De Paradise émane une beauté troublée, récurrente, qui en fait un album majeur. Dont le final, ce Horn’s lament magique, étincèle là où, chez d’autres, on « remplit pour boucler l’ouvrage ». Ici pas de tout ça, on porte un son tout particulier à chacune des compositions offertes. Là aussi, c’est ce qui différencie les artistes de référence, soucieux du moindre détail, de la cohorte de ceux qui se contentent de bien faire… ou de faire et là, c’est plus pire comme dirait l’autre.
L’issue, il va de soi, l’illustre bien. A aucun moment et quand bien même, je le réitère, Da Capo pourrait « gronder » plus souvent encore, on n’éprouve lassitude ou sentiment de creux. L’opus est complet, captivant, et qualitativement irréprochable. Sa pochette, même, plaira et fera émerger un « ailleurs » stimulant pour l’esprit. Après By the river, il y a tout juste deux ans, Da Capo pose donc une pierre de plus, bien campée, sur un ouvrage musical sans cesse croissant et parfaitement cimenté.